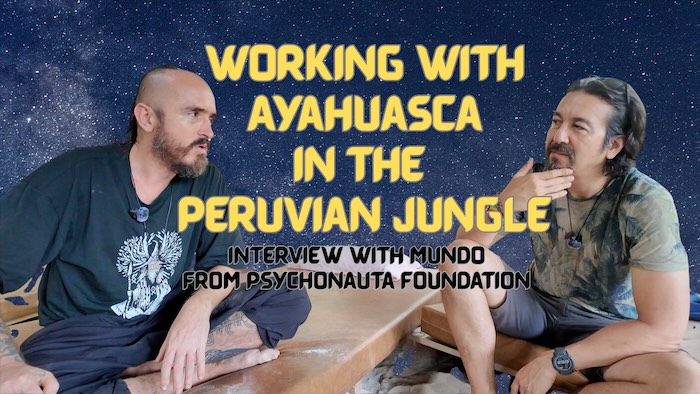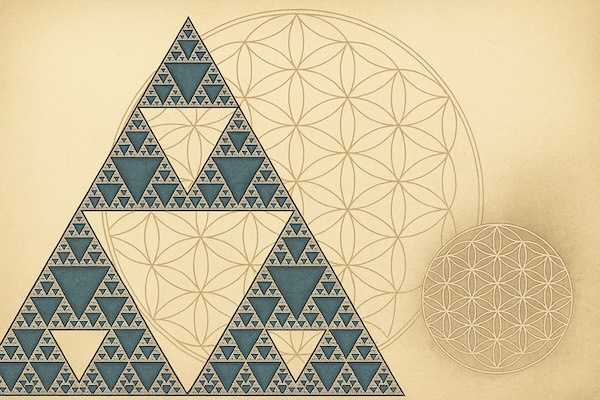La technique de la chaise vide est l’un des outils expérientiels les plus puissants utilisés en psychothérapie et en animation pour résoudre les conversations inachevées, accéder aux couches émotionnelles les plus profondes et intégrer les parties internes. C’est un outil que j’utilise fréquemment en thérapie individuelle et en thérapie de groupe, car il permet de créer un espace pour se connecter à la complexité des émotions et des pensées qui ne sont pas facilement accessibles par le biais de la conversation d’intégration avec le participant.
Bien qu’il puisse sembler simple à première vue, guider ce processus de manière sûre et efficace nécessite de la clarté, de la présence et une approche bien structurée. Ce guide offre aux étudiants et aux facilitateurs débutants un cadre étape par étape pour mener l’exercice de la chaise vide en toute confiance – en maintenant la sécurité émotionnelle, en encourageant la conscience corporelle et en aidant les clients à évoluer vers une transformation significative.
| Étape | Ce que vous faites | Comment guider le processus en tant que thérapeute |
| 1 | Écoutez et trouvez la conversation inachevée | Commencez par écouter attentivement le client : ses besoins, ses points douloureux, ses situations récurrentes et ses relations importantes. À partir de là, aidez-le à identifier une conversation spécifique inachevée ou un dialogue intérieur clé (avec une autre personne, avec lui-même, avec un symptôme, avec une émotion, etc.) |
| 2 | Clarifier l’objectif de la chaise vide | Avec le client, définissez un objectif clair : par exemple, avoir une conversation inachevée, répéter une conversation redoutée ou donner la parole à une partie intérieure qui ne s’exprime jamais. Un objectif clair vous aidera à contenir le processus et à reconnaître le moment où l’expérience a atteint un point de clôture naturel. |
| 3 | Proposer et expliquer l’expérience | Expliquez dans un langage simple ce qu’est la chaise vide, pourquoi elle pourrait être utile dans leur situation et ce qui pourrait se produire (émotions intenses, prise de conscience, soulagement, résistance). Demandez un consentement explicite et insistez sur le fait que le client peut faire une pause, ralentir ou s’arrêter à tout moment. Cela renforce la sécurité et le sentiment de contrôle. |
| 4 | Demandez une description physique de ce qui sera assis sur la chaise. | Avant de placer la chaise, demandez au client de décrire la personne ou l’objet qui s’y assoira : apparence physique, posture, gestes, expressions faciales typiques, ton de la voix, façon de regarder. S’il s’agit d’une partie intérieure, invitez-le à l’imaginer comme si elle avait un corps. Cela rend l’expérience plus concrète et plus incarnée. |
| 5 | Positionnez la/les chaise(s) | Placez la chaise vide dans la pièce et décidez si vous utiliserez une ou plusieurs chaises, et à quelle distance. La distance n’est pas neutre : une chaise très proche peut intensifier l’émotion ; une chaise plus éloignée peut accroître le sentiment de sécurité. Vous pouvez demander : « À quelle distance aimeriez-vous avoir cette personne/cette partie ? » et ajuster en conséquence. |
| 6 | Invitez le client à s’adresser directement à la personne/partie | Demandez au client de parler à la deuxième personne, comme si la personne ou la partie était réellement assise là : « Parlez-leur comme s’ils étaient ici en ce moment. Dites ce que vous ne pourriez jamais dire. Votre rôle est de soutenir, d’encourager l’authenticité et d’aider le discours à rester connecté et incarné, tout en surveillant le rythme et l’intensité. |
| 7 | Refléter les aspects non verbaux et favoriser la prise de conscience du corps | Pendant que le client parle, observez son corps : posture, respiration, tension, gestes. Faites doucement écho à ce que vous voyez, par exemple : « Je remarque que votre poitrine se ferme lorsque vous dites cela », « Vos mains se crispent », « Vous vous penchez en arrière lorsque vous leur parlez ». Cela aide le client à prendre conscience de la façon dont il maintient le conflit dans son corps. |
| 8 | Encourager la communication émotionnelle dans le cadre de la tolérance | Invitez le client à parler non seulement de sa tête, mais aussi de ses émotions. Réfléchissez aux émotions possibles (« Je sens beaucoup de colère ici », « On dirait qu’il y a de la tristesse là-dessous ») et encouragez-les à les exprimer plus complètement. Parfois, suggérer une légère exagération d’un geste, d’une posture ou d’un ton peut aider l’émotion à devenir plus consciente. En même temps, surveillez leur fenêtre de tolérance : s’ils deviennent submergés ou dissociés, diminuez l’intensité, introduisez une mise à la terre ou une régulation, ou suggérez une pause. |
| 9 | Décidez s’il y aura un changement de chaise (et pourquoi) | Demandez-vous s’il serait utile que le client change de chaise et se place du point de vue de l’autre personne ou de l’autre partie, et réponde à partir de là. Dans d’autres cas, il peut être préférable de rester sur la même chaise. Ce qui importe, c’est que la décision de changer de chaise ait un objectif clair : écouter l’autre partie, comprendre son point de vue ou fixer des limites à partir d’une nouvelle position. |
| 10 | En cas de changement de chaire : donnez du temps pour vous connecter | Si le client change de chaise, ne précipitez pas sa réponse. Invitez à un bref silence : « Prenez un moment pour ressentir ce que c’est que d’être à la place de cette personne/partie. Que remarquez-vous dans votre corps ? Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ? » Cette pause permet d’obtenir une réponse plus authentique plutôt que purement mentale. |
| 11 | En cas de changement de chaire : résumez ce qui a été exprimé | Avant que le client ne réponde dans sa nouvelle position, résumez brièvement ce qui a été dit dans l’autre fauteuil, par exemple : « L’autre personne vous a dit qu’elle se sentait très seule, qu’on ne s’occupait pas d’elle et qu’elle était blessée parce que vous n’étiez pas là ». Cela permet de cibler la réponse et d’aider le client à ressentir l’impact de ce qu’il a entendu. |
| 12 | Demandez s’il y a autre chose à exprimer avant de conclure. | Avant de conclure, demandez si quelque chose d’important n’a pas encore été dit : « Avez-vous encore quelque chose à dire avant de clore cette conversation ? » Cela réduit le risque de laisser l’expérience avec un sentiment d’inachevé et laisse de la place pour les dernières nuances, les adieux ou les limites. |
| 13 | Ancrer ou symboliser la transformation | Marquez le changement interne d’une manière tangible afin que l’expérience ne reste pas seulement une scène intense. Vous pouvez inviter le client à remarquer ce qui a changé dans son corps et à quel endroit ; suggérer de déplacer la chaise (plus près, plus loin, tournée, retirée de l’espace) ; ou lui demander de trouver une image, une phrase ou un geste qui symbolise la transformation. Cela permet de consolider le travail et de favoriser l’intégration. |
| 14 | Après le travail de la chaise : intégrer les questions de sensibilisation | Pour terminer, soutenez l’intégration en posant des questions simples mais profondes, telles que : « Qu’avez-vous réalisé au cours de cet exercice ? « Qu’avez-vous réalisé au cours de cet exercice ? », « Comment vous sentez-vous maintenant par rapport à avant ? », « Qu’aimeriez-vous tirer de cette expérience dans votre vie de tous les jours ? » Ces questions relient l’expérience au processus thérapeutique plus large et aident le client à donner un sens personnel à ce qui s’est passé. |
La chaise vide est un outil utile qui permet d’entrer en contact avec le processus personnel d’un participant et de guider l’intégration d’un groupe dans un champ d’ouverture et de confiance.